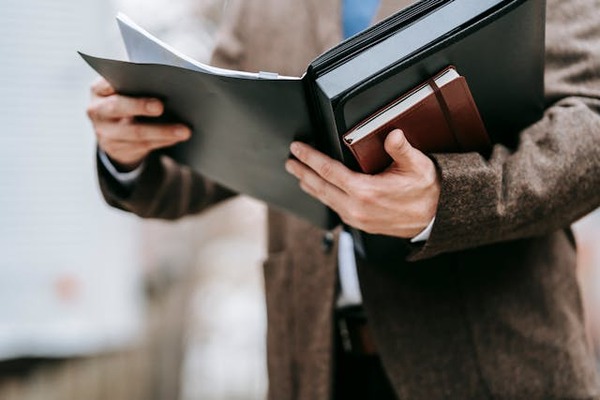Pour pouvoir devenir un associé au sein d’une société commerciale ou civile telle qu’une
SCI imposable à l’IR ou une SCI à l’IS, une personne doit réaliser un apport. Pour cela, 3 possibilités s’offrent à la personne, soit elle réalise un
apport en numéraire, donc, en argent, soit
en industrie ou en apportant des valeurs intellectuelles. Mais il est aussi possible pour la personne de réaliser des
apports en nature dans le capital social de l’entreprise. Dans cet article, on va surtout se focaliser sur ce dernier type d’apport qu’est l’apport en nature. On verra dans ce cas, ce qu’est l’apport en nature, comment l’évaluer et les conséquences juridiques sur la société et l’associé.
Spécificités et fonctionnement de l’apport en nature dans une société
L’apport en nature dans le capital social d’une entreprise par définition
L’apport dans le capital social d’une société est un élément obligatoire pour pouvoir réaliser la création d’une entreprise et obtenir un Kbis. Concernant l’apport en nature, il s’agit
d’actifs autres que l’argent, qui peuvent être tangibles, corporels ou incorporels et qui peuvent s’injecter dans le patrimoine social de la société. En d’autres termes, l’apport en nature peut
être un bien meuble ou un bien immeuble. Comme exemple, on parle de biens corporels pour les biens qu’on peut toucher et déplacer. Cela concerne les véhicules en tout genre, les matériels informatiques, les mobiliers de bureau, etc. Pour ce qui est des biens incorporels qu’on peut catégoriser d’apport en nature, il y a les logiciels et applications, les différents brevets, les clients, etc. Et enfin, vous avez les biens immobiliers que ce soit les terrains ou les bâtiments qu’on classe également comme apport en nature utile dans la création d’une entreprise. Il faut noter que les entreprises individuelles et micro-entreprises ne sont pas concernées par l’apport en nature ni la constitution de capital social. L’apport en nature concerne seulement les sociétés commerciales ainsi que les sociétés civiles. De ce fait, vous pouvez injecter un apport en nature comme défini en haut si vous voulez devenir associé de l’un des types de sociétés qui suivent :
Pourquoi opter pour l’apport en nature afin devenir associé d’une entreprise ?
Dans un premier temps, réaliser un apport en nature dans une société permet de mettre à la disposition de cette dernière un bien
utilisable dans l’immédiat. Cela est pratique si la société n’a pas besoin de rechercher du financement pour lancer ses activités. Ce sera aussi le cas pour éviter de faire des acquisitions spécifiques nécessitant l’utilisation de fonds. Par ailleurs, l’apport en nature est réalisé par les associés lorsqu’ils procèdent à la
création de la société. Une fois l’apport en nature réalisé, ces associés recevront des parts sociales, des titres ou des actions au sein de l’entreprise. Ainsi, la part ou l’action obtenue sera définie en fonction de l’apport en nature réalisé. Ce qui permettra aussi de
définir la part de dividendes que chaque associé obtiendra à la fin de chaque exercice fiscal. Il faut par contre noter qu’une fois l’immatriculation de la société obtenue, les associés peuvent à nouveau réaliser des apports dans le capital social de l’entreprise. Et cela, en vue d’assurer l’augmentation son patrimoine social.
Apport en nature : les droits acquis par la société
Une fois l’apport en nature réalisée, les droits de la société sur le bien apporté peuvent varier. En effet, il est possible que
la société jouisse pleinement de l’apport en nature réalisé. Dans ce cas, l’associé qui réalise l’apport en nature du bien va transmettre la propriété du bien à l’entreprise. Cette dernière pourra ensuite en faire usage à sa guise et récolter les fruits issus du bien. Il est également possible
qu’elle jouisse seulement du bien apporté par l’associé dans le capital social de l’entreprise. Pour ce cas,
la société n’aura pas la pleine propriété du bien apporté par l’associé. En effet, l’associé peut mettre le bien à la disposition de la société. Par contre, il en sera toujours le propriétaire et peut demander sa récupération lorsque le contrat entre les deux personnes arrive à son terme. Autrement dit, la société peut utiliser le bien, mais elle n’en récoltera pas les fruits. Comme exemple, une personne a apporté un local pour devenir associé d’une entreprise. Par principe de jouissance, la société peut assurer la décoration de cette dernière et y installer les bureaux de son personnel. Cependant, elle n’aura pas le droit d’apporter des changements majeurs, sur la structure et l’enveloppe du bâtiment, comme d’abattre un mur par exemple. On peut aussi, pour terminer, envisager que la société en
perçoive seulement l’usufruit. Dans ce cas, le bien n’est pas la propriété de la société, mais elle peut en récolter les fruits comme les loyers ou autres revenus générés par le bien. Ce sera par exemple le cas des SCI qui gèrent des biens immobiliers.
Réaliser un apport en nature, comment s’y prendre ?
Faire le bon choix du bien pour l’apport en nature
Le futur associé doit choisir avec minutie le bien qu’il souhaite intégrer dans le patrimoine social de la société. De ce fait, il est important que ce bien soit :
- Possible à évaluer et à tarifer,
- Transférable. En ce sens, la société doit avoir la possibilité de jouir de la propriété à 100 % ou en partie,
- Utilisable par l’associé de manière libre.
Il est également obligatoire que l’associé ait les documents nécessaires pour justifier que le bien est sa propriété. On doit aussi s’assurer que l’associé fasse une
garantie afin de couvrir les risques. Comme risques, les cas suivants peuvent se présenter :
- Vices cachés. En effet, le bien apporté en nature par l’associé ne doit pas présenter de vices qui impacteraient l’utilisation prévue. Cette disposition est indiquée par le Code civil, dans son article 1641.
- La société doit avoir la possibilité de jouir du bien apporté en toute quiétude.
Pour le cas d’un apport en brevet, il est important que l’apporteur informe l’INPI et que ce brevet soit enregistré. Son enregistrement est à faire au niveau du registre national des brevets. Dans le cas d’une marque, son enregistrement se fait au niveau du registre national des marques.
Faire évaluer l’apport en nature par un commissaire aux apports
L’une des spécificités de l’apport en nature c’est qu’il doit
être évalué par un spécialiste. Pour cela, un commissaire aux apports se charge de l’évaluation du bien. L’objectif dans ce cas, c’est d’éviter que l’apport soit surestimé lorsqu’il est intégré dans le capital social de la société. En effet, une surestimation aura des impacts sur la valeur totale du capital de l’entreprise, mais aussi sur la part sociale que l’associé apporteur va avoir. Ainsi, l’objectif du commissaire aux apports est de
donner une valeur financière réelle au bien et de consigner ses constats dans un rapport. Par ailleurs, il faut noter que le législateur exige l’intervention de ce professionnel pour les SAS, les SASU ainsi que les SA. Pour ce qui est des EURL et SARL, il faudra respecter l’une des conditions qui suivent pour pouvoir faire appel à un commissaire aux apports :
- Valeur estimée de l’apport en nature supérieure à 30 000 euros,
- Valeur estimée de l’apport en nature supérieure à la moitié du montant total du capital social.
Dès lors que le commissaire aux apports a terminé son évaluation et qu’il a rendu son rapport, ledit apport sera enregistré dans les statuts de l’entreprise. De ce fait, dans la clause qui consigne les spécificités de l’apport en nature, on indiquera :
- Les types de biens apportés à l’entreprise,
- La valeur des apports en nature,
- Le nombre de parts sociales que l’associé a reçu en contrepartie.
Procéder à la libération de l’apport en nature
Le rapport du commissaire aux apports et la clause concernant l’apport en nature effectués, il faudra ensuite procéder à la
signature des statuts de la société. Ceci étant, les associés de la société pourront procéder à la libération des apports concernés. Cela va permettre de mettre à la disposition de la société, les biens définis comme étant des apports en nature. Elle pourra ensuite en faire usage pour pouvoir réaliser son objet social. Pour ce faire, une fois que les statuts sont signés par les associés, il faudra procéder à la libération des apports en nature. Il s’agira de les
libérer en totalité. En effet, contrairement à l’apport en numéraire, on ne peut pas libérer les apports en nature de manière partielle. Ce qui veut dire que les biens faisant partie des apports doivent être utilisables dans l’immédiat par la société bénéficiaire.
Pourquoi l’évaluation de l’apport en nature est-elle importante ?
Lorsque l’associé injecte un apport en nature dans le capital social d’une société, il obtient en retour des titres sociaux. En fonction du statut juridique de l’entreprise, il peut obtenir des parts sociales ou des actions. Ainsi, lorsqu’il reçoit ces titres, il pourra aussi jouir de droits divers :
- Jouir des bénéfices que la société dégage,
- Bénéficier d’un droit de vote lors des assemblées générales des actionnaires ou des associés de l’entreprise,
- Être informé de la situation de l’entreprise.
De ce fait, il est nécessaire de bien évaluer les apports en nature apportés à l’entreprise. Et cela, parce qu’ils ont un impact considérable sur ces droits. En ce sens, dans le cas où l’apport est mal évalué, cela aura des répercussions sur les parts à partager. Un apport en nature sous-évalué par exemple, ne permettra pas à l’associé apporteur de jouir des parts sociales dont il devrait bénéficier. Si au contraire, l’apport est surestimé, il y aura des conséquences sur les créanciers potentiels. Afin d’éviter ce problème, le rôle du commissaire aux apports est important. Il aura à fixer la valeur réelle et définitive du bien apporté. Ensuite, il reviendra aux associés d’assurer la définition du montant final de l’apport en nature. Ils se chargeront aussi de déterminer les parts ou les actions qui seront octroyées à l’associé. Ces décisions se feront grâce à un vote des associés et se feront sans la présence de l’associé apporteur du bien concerné.
Quelques risques et contraintes à noter
L’apport en nature par
une personne physique ou une personne morale exige une évaluation comme on l’a vu. Ce qui peut conduire à un
respect de démarches et de formalités strictes. En effet, l’évaluation et la déclaration du montant de l’apport en nature sont importantes. Cependant, il faut aussi prendre en compte et appliquer un cadrage légal strict. Cela concerne entre autres, le passage par les
services d’un notaire. À noter également que le professionnel chargé de l’évaluation doit
être un commissaire aux apports agréé. En ce sens qu’en cas de constat de surestimation d’un apport en nature, des conséquences juridiques non négligeables peuvent survenir. Sachez également qu’en faisant un apport en nature, l’associé n’aura plus plein droit sur le bien apporté. Il deviendra la propriété de la société. Et enfin, sachez qu’il existe des biens qui ne peuvent faire l’objet d’un apport en nature. Cela concerne par exemple, les licences non permanentes et tous les actifs qu’il est impossible de transférer.
Création d’une entreprise : par quelles étapes passées ?
Avant de pouvoir devenir un associé d’une entreprise et faire un apport en nature, vous devez considérer les démarches qui suivent :
- Opter pour un statut juridique qui doit être une société commerciale (SAS, EURL, SASU ou SARL) ou une société civile (SCI),
- Rassembler les apports incluant les apports en nature afin de constituer le capital social. Ce sera durant cette étape qu’on fera intervenir le commissaire aux apports,
- Rédiger les statuts de la société. Ils doivent inclure les clauses de valorisations des parts des associés,
- Déposer le capital social chez un notaire ou le compte bancaire de l’entreprise,
- Diffuser une annonce légale de constitution de la société. Cette démarche est à faire dans un journal d’annonce légale ou sur un support de publication légale en ligne,
- Immatriculer l’entreprise. La demande d’immatriculation devra dans ce cas, se faire sur la plateforme en ligne de l’INPI, sur le guichet unique pour les formalités d’entreprise. À l’issu de cette étape, la société sera enregistrée au RCS. Elle aura également un numéro siret, un numéro d’immatriculation ainsi qu’un extrait kbis.
A noter qu'après cette démarche de création, vous pouvez demande une
aide à la création d'entreprise à Pôle emploi.
 Pour pouvoir devenir un associé au sein d’une société commerciale ou civile telle qu’une SCI imposable à l’IR ou une SCI à l’IS, une personne doit réaliser un apport. Pour cela, 3 possibilités s’offrent à la personne, soit elle réalise un apport en numéraire, donc, en argent, soit en industrie ou en apportant des valeurs intellectuelles. Mais il est aussi possible pour la personne de réaliser des apports en nature dans le capital social de l’entreprise. Dans cet article, on va surtout se focaliser sur ce dernier type d’apport qu’est l’apport en nature. On verra dans ce cas, ce qu’est l’apport en nature, comment l’évaluer et les conséquences juridiques sur la société et l’associé.
Pour pouvoir devenir un associé au sein d’une société commerciale ou civile telle qu’une SCI imposable à l’IR ou une SCI à l’IS, une personne doit réaliser un apport. Pour cela, 3 possibilités s’offrent à la personne, soit elle réalise un apport en numéraire, donc, en argent, soit en industrie ou en apportant des valeurs intellectuelles. Mais il est aussi possible pour la personne de réaliser des apports en nature dans le capital social de l’entreprise. Dans cet article, on va surtout se focaliser sur ce dernier type d’apport qu’est l’apport en nature. On verra dans ce cas, ce qu’est l’apport en nature, comment l’évaluer et les conséquences juridiques sur la société et l’associé.